Porte Richelieu


Cet article est une ébauche concernant Paris et l’architecture ou l’urbanisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

| Type | Porte de ville |
|---|---|
| Construction | 1634 |
| Démolition | 1701 |
| Hauteur | Env. 20 |
| État de conservation | démoli ou détruit (d)  |
| Pays | Royaume de France |
|---|---|
| Commune | Paris |
| Coordonnées | 48° 52′ 11″ N, 2° 20′ 21″ E |
|---|
  |
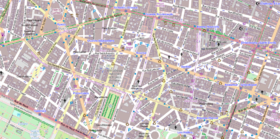  |
  |
modifier - modifier le code - modifier Wikidata
La porte Richelieu est une porte disparue de Paris de l'enceinte de Louis XIII qui s'élevait au XVIIe siècle sur l'axe de la rue de Richelieu.

Situation
La porte se trouvait sur le tracé de la rue de Richelieu, entre les rues Saint-Augustin et Neuve-des-Fossés-Montmartre (actuelle rue Feydeau), et plus précisément entre les rues de la Bourse et du Quatre-Septembre actuelles, alors inexistantes[1],[2].
Histoire
Un traité est signé entre le roi et un dénommé Charles Froger — commis et prête-nom du spéculateur Louis Le Barbier — le , en vue du lotissement du faubourg Richelieu. Une clause prévoit que le promoteur devra construire une porte sur la nouvelle rue de Richelieu[3]. Élevée en 1634[4], elle est alors l'une des trois seules portes du nouveau rempart construit sous le règne de Louis XIII, dit enceinte des Fossés jaunes, pour agrandir la rive droite de la ville par l'ouest et ainsi intégrer intra muros le faubourg construit par le cardinal de Richelieu. La porte fut démolie en 1701[5].
Au-delà de la porte, la rue de Richelieu porta les noms de « rue du Faubourg-Richelieu » et « rue de la Grange-Batelière[6] ».
Notes et références
- ↑ Voir le plan de Bullet et Blondel.
- ↑ « L’enceinte bastionnée, dite des Fossés jaunes, vers 1650 », paris-atlas-historique.fr (consulté le 5 mars 2019).
- ↑ Louis Batiffol, La Vie de Paris sous Louis XIII, Éditions Calmann-Lévy, 1932, p. 12.
- ↑ Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), (lire en ligne), p. 1.
- ↑ Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, 1817, p. 512. Lire en ligne..
- ↑ « Communication de M. Dumolin sur les origines du passage des Panoramas », procès-verbal de la Commission du Vieux Paris de la séance du 29 juin 1929, p. 83. Lire en ligne.
 Portail de Paris
Portail de Paris










